Résumé
Le Tribunal étoile sera une institution non gouvernementale servant à donner accès à la justice aux personnes qui en ont besoin et y ont le moins accès (personnes faisant partie de catégories opprimées, qui ne peuvent ou ne veulent pas faire appel à l’institution gouvernementale : enfant·es, femmes, personnes trans, personnes racisées, etc.). A cette fin, ce collectif pratique une forme de justice restaurative ayant principalement pour objet le bien-être des personnes opprimées. Il soutient la traversée de conflit pour les familles, communautés, squat, associations, etc., en intervenant quand le besoin d’un tiers se fait ressentir.
Entre autres objectifs conséquents du premier objectif, le tribunal étoile cherchera à :
- expérimenter la traversée de conflit de manières variées,
- expérimenter comment « rendre justice » de manières variées,
- produire du contenu pour l’autonomisation des collectifs (communautés, familles, associations) dans leurs propres traversées de conflit,
- rendre au peuple sa souveraineté dans la gestion des conflits,
- œuvrer au bien-être des personnes marginalisées par notre culture,
- modifier la culture de la justice de notre société en l’ouvrant vers d’autres voies que la justice punitive,
- affirmer la volonté de l’inclusion des personnes marginalisées dans la société
- et assumer une lutte contre toute volonté contraire.
Pourquoi un Tribunal étoile ?
Originellement, « tribunal féministe ». Je vivais une situation de conflit suffisamment grave pour me qu’elle me mène un jour en burnout. Mais peu avant, ressentant le besoin d’un soutien, je souhaitais de tout mon cœur que quelqu’un·e rende justice sur ma situation : n’y avait-il pas une personne au monde qui pouvait avoir un point de vue féministe ? Je ne voulais pas qu’on me brosse dans le sens du poil. Je voulais un point de vue complexe, intelligent, critique, sérieux, créatif, ouvert, et collégial. Et je ne voulais pas d’une « résolution de problème ». Je ne considérais pas que ce problème soit réellement soluble, étant prise dans les contraintes de la société à laquelle j’appartiens. Mais je rêvais qu’on rende justice sur ma situation. Je rêvais d’entendre : « ce n’est pas juste qu’il te traite comme ça, il est violent avec toi. Et là par contre, c’est toi qui es violente ». Car étant l’unique féministe de la situation, je devais à la fois tenir le rôle de victime et le rôle de juge féministe, ce qui est un double rôle lourd et intenable.
Une fois cuite par ce conflit (qui n’est toujours pas terminé aujourd’hui mais a perdu de sa vivacité), j’ai trouvé intéressant d’appliquer ce besoin à d’autres personnes que moi, concernées par d’autres oppressions : n’y avait-il pas un enfant dans le monde qui avait besoin qu’on lui dise, d’un même chœur, « ce que tu vis n’est pas normal, ce qu’il se passe n’est pas juste« , n’y avait-il pas un couple de personnes trans qui cherchait du soutien pour savoir comment continuer à prendre soin d’elleux dans un système impitoyable, qui cherchait du soutien pour savoir comment se positionner, sans pour autant se trouver coupable de crimes ? N’y avait-il pas des personnes qui cherchaient à « trouver justice », sans en être réduites à « faire justice elles-mêmes » ? N’est-on pas plusieurs à trouver qu’il est trop lourd d’être à la fois victime et juge ? Il me semblait finalement que cette position qui produit tant de perte d’énergie et de conflits internes était propre au statut de faire partie d’une catégorie d’opprimé·e qui lutte (car nombre d’entre nous ne cherchent même plus à lutter, écrasé·es qu’iels sont par l’oppression qu’iels subissent). Et il m’est enfin apparu que se voir « rendre justice » était finalement un privilège.
C’est en lisant le travail de Sylvia Vatuk The “women’s court” in India: an alternative dispute resolution body for women in distress que je prends conscience que des entités populaires pourraient exister pour prendre le relai d’une institution bancale, incapable de nous accueillir. Le travail des femmes indiennes me saisit et je me rends compte que nous avons en fait la possibilité de constituer des espaces où nous rendre justice collectivement. Le travail de Sylvia Vatuk présente un intérêt non-négligeable. Il est une observation critique de ces organisations de justice populaire indiennes, et offre de ce fait un retour sur des sujets aussi passionnants que : l’utilisation d’une justice en non-mixité, la tentative d’une pratique de tribunal populaire non-classiste, les particularités d’une justice « entre femmes » pour en citer quelques-uns. De quoi imaginer une justice étoile à partir d’autre chose qu’une page blanche… (Je vous encourage sérieusement à lire cet article, que je ne connais malheureusement qu’en anglais.)
Enfin, sensible à l’agisme et sensibilisée au racisme, puis par extension sensibilisée progressivement aux oppressions systémiques de manière générale (ça ne finira jamais, si ?), je suis préoccupée par le fait qu’un tel tribunal populaire ne devrait pas être exclusivement féministe, mais devrait prendre en compte toute oppression. Justice « féministe » m’a semblé assez rapidement centré uniquement sur ma problématique (et encore pas tout à fait puisqu’il y avait une problématique concernant l’agisme), et j’ai cherché un terme qui englobait toutes ces personnes marginalisées par le système, qui ne peuvent pas faire appel à une justice capitaliste, classiste et patriarcale pour penser et traiter leur situation. Dans mes cahiers, je notais « tribunal *« , dans l’attente du bon terme. Mais ce bon terme, je ne l’ai jamais trouvé. Puis un jour en me relisant mon fameux « Tribunal * » à l’oral, j’ai énoncé « tribunal étoile » et cette expression a sonné dans ma tête comme excellente pour intégrer toutes les personnes que je souhaitais désigner. Depuis je chéris cette fameuse étoile, qui a bientôt proliféré dans mon vocabulaire, se faisant une place auprès d’autres mots pour former « personne étoile » et « justice étoile » (et spoiler alert : si on doit concrétiser ce projet collectivement, je risque de montrer les crocs si on veut changer le nom, haha !).
Où en est-on ?
- Ce projet est actuellement individuel. Le premier pas est donc de rassembler les personnes intéressées par une telle ambition. Une fois les premières personnes rassemblées, je m’attends à ce que les items suivants soient modifiés, mais pour l’instant, voici ce que je vois :
- Les personnes présentes vont élaborer des critères leur permettant de « recruter » le tribunal. Il faut donc clarifier quelles compétences nous semblent essentielles pour faire partie d’un tel tribunal, et même auparavant, clarifier quels rôles sont à prendre, donc commencer à élaborer à quoi devrait ressembler une « justice étoile » d’après nous. Il s’agit d’un gros travail de synthèse des différentes expériences que nous avons dans le domaine de la traversée de conflit (pratique et théorique).
- Qu’est-ce que la justice étoile ? A-t-elle des lois ? Dans quelle mesure fonctionne-t-elle ou se distingue-t-elle de la justice punitive ? Quelles sont les croyances mobilisées ? Quels sont les faits scientifiques sur lesquels elle repose ? Quelles sont ses limites ?
- Qu’est-ce qu’une personne compétente dans le domaine de la justice étoile ?
- Quelles sont les différentes compétences à rassembler pour être une personne « safe » pour faciliter la traversée de conflits ?
- Quelles sont les différentes compétences à rassembler pour superviser une traversée de conflit ?
- Y a-t-il des compétences à rassembler pour qu’une personne prise dans son conflit le traverse ? Si oui, dans quelle mesure est-il possible de rendre ces compétences accessibles ?
- Etc.
- Recruter des personnes, cette fois-ci avec plus de clarté sur la justice étoile. En d’autres termes, chercher « de la ressource humaine » avec des objectifs plus ciblé.
- Imaginer un fonctionnement financier compatible avec le projet
- Ouvrir la réflexion des projets « parallèles »
Design par AM
Compétences
Le chapitre « compétences » recoupe les problématiques soulevées dans le cadre de la constitution d’une compréhension des différentes compétences que l’on retrouve dans la justice étoile. On part du principe que la justice étoile est très différente dans la justice habituelle, car, sans les avoir définies pour l’instant, nous avons l’intuition que les notions-mêmes de « justice », « tort » ou « violence » pourraient bien avoir un sens très différent dans la justice étoile. Dès lors, les compétences que l’on trouve chez les personnes constituant le tribunal étoile, en terme de « posture » (savoir-être) et en terme de connaissances, restent à définir.
Par exemple, faire l’estimation d’une violence dans une situation donnée pourrait davantage nécessité de pratiquer une bonne écoute empathique (justice étoile) que de connaître un texte de loi (justice institutionnelle). Les compétences permettant d’évaluer si une personne est apte à donner une écoute empathique de qualité sont à définir, car il n’existe pas à ce jour, à ma connaissance, de support d’une telle évaluation. Définir, comparer, voire inventer les compétences nécessaires à la justice étoile est l’objet de ce chapitre.
Risque de « CV militant »
L’un des risques possibles, c’est qu’on ait envie de jouer à « qui c’est qu’a la plus grosse » en terme de connaissance sur les oppressions. On trouve cet écueil chez les militant.es. En fait, on peut supposer que ce phénomène tient justement au manque de repères concernant ce qu’on devrait savoir, ce qui est à savoir, ce qui est avant-gardiste, ce qui est juste de l’ignorance qui se camoufle, etc.
Prendre soin de ses limites
L’intérêt de clarifier les compétences que les protagonistes du tribunal ont ou n’ont pas, c’est qu’elles puissent d’investir à des endroits dans lesquelles elles sont compétentes, et avertir de leur incompétence sur certains sujets. Ainsi, on évite le drame du prof de piano qui doit enseigner l’improvisation alors qu’il sort du conservatoire, où il n’a jamais appris à improviser… Le biais d’engagement crée chez la personne identifiée « ressource » une gêne propice à lui faire simuler cette compétence qui est en fait absente chez ellui, et un fort syndrome de l’imposteur.ice. Afin de s’engager sur la base d’un profil de compétences clair, on permet aux personnes de savoir à quoi s’attendre, et à quoi ne pas s’attendre de notre part, et on soulage des attentes inadaptées que l’on pourrait poser sur nous.
Prendre soin des limites des autres
L’intérêt de clarifier les compétences utiles à la justice *, c’est aussi d’éviter que des personnes facilement en confiance attendent des effets « magiques » de la part du tribunal *, comme changer l’eau en vin, par exemple. L’effet de halo, très courant dans les milieux du développement personnel, peut mener à une réelle charlatanerie. Si nous reprenons l’exemple du prof de piano : surfer sur le manque de connaissance de l’élève pianiste pour faire croire que « parce que je suis prof de piano je peux te faire devenir n’importe quel type de pianiste » est un simple abus d’autorité. En effet, être pinaiste recouvre des compétences tellements variées que tout.e pianiste est nécessairement limité.e, dans sa pratique et dans son enseignement.
Je n’ai jamais eu accès à une liste des compétences dans le domaine de « l’intelligence relationnelle », ni à une définition de ces compétences, et encore moins à des repères permettant d’évaluer les compétences en termes d’écoute, de présence, ou de posture. Cette lacune permet à n’importe quelle personne de bénéficier de ses privilèges pour paraître compétent.e sans l’être, et abuser :
- des personnes en posture d’apprenant.e, qui ne sont pas en mesure de se rendre compte que la personne est en réalité incompétence,
- des personnes qui sont réellement compétentes mais ont un éthos moins imposant.
Qu’il soit utilisé par inconscience de rang ou qu’il soit utilisé sciemment dans l’objectif de se faire passer pour plus compétent.e qu’on ne l’est, il s’agit dans tous les cas un mécanisme que l’on espèce diminuer en faisant faire un travail de clarification des compétences des protagonistes du Tribunal *, qui a pour objectif d’être publicité, assurant ainsi une forme de transparence. Le bénéfices pour les personnes se prêtant à ce jeu est prendre soin de ses limites.
Les projets parallèles
Le cœur du tribunal étoile est une implication pratique dans le conflit. Mais s’il me semble important d’agir par le faire, il me semble aussi important d’agiter la notion même de conflit, mettre un gros coup de touillette dans la soupe actuelle, déplacer les idées préconçues sur le conflit et par ce fait, ouvrir notre créativité à tous et toutes. De la même manière que nous avons besoin de voir des femmes puissantes, de chiner les personnages célèbres noir·es à travers notre histoire tristement coloniale, d’entendre les voix des enfants, nous avons besoin de penser, de voir, et d’entendre parler des conflits autrement. Nous avons besoin de croire que traverser les conflits n’est pas qu’une souffrance mais transformateur. Nous avons besoin d’imaginaires et de témoignages. Et pour ça, l’art, le rire, les rituels, et toute activité n’étant pas dévolue à traverser les conflits stricto sensus doit être portée.
Brainstorming de projets parallèles
Suit dans cette liste des projets rêvés, des envies de chocolat, qui sortent de la calebasse qui me sert de cerveau. Ce sont les enfants que je n’aurai jamais avec les personnes que j’aime (parce que oui, ces projets n’ont pas que mes gênes !). Ils n’ont que peu de chances de voir le jour, et je vous les propose en guise de touillette. Parce que vous, vous rêvez de quoi, au fait ?
Process Work filmé
Il y a des moments de grâce dans les traversées de conflit. Moi j’en suis addict. Et autant, je trouvais que les Cercles Restauratifs c’est gracieux mais super ennuyant, autant le Process Work c’est pêchu, c’est intense, c’est théâtral… C’est quand qu’on met ça en film, Robyn Chien ?
Toy Party : le jugement dernier des humain·es par les dinos
Vous connaissez la Toy Party ? Bande de déluré·es que j’ai eu le plaisir d’approcher d’un peu pas trop près ou d’un peu trop près. Collectif fini (mais comme c’est des cousin·es, les liens de sang, c’est pour toujours, nan ?). Gros potentiel con et cul, et ça c’est… hiiii !
Brutus et Brutusses – procès dans l’maquis
On juge : les passeurs, les chef·fes d’État, le chien de garde. On juge les frontières du centre de l’Afrique que Loveth a dû contourner, enceinte, pour fuir la guerre. On juge le formulaire de l’hôpital qu’elle ne peut pas remplir sans dévoiler une situation qui lui vaudra un aller simple vers un chez-elle qui n’existe plus. On juge la carcasse de l’avion qui explosé au-dessus du village. On organise le procès de la famine, de l’argent européen, d’Allah, de Jésus, de Mahomet.
Maxime Actis a déjà réuni les Brutus·ses alors, tant qu’ils et elles sont en marche, pourquoi qu’on ferait pas un gentil, tout gentil petit procès ?
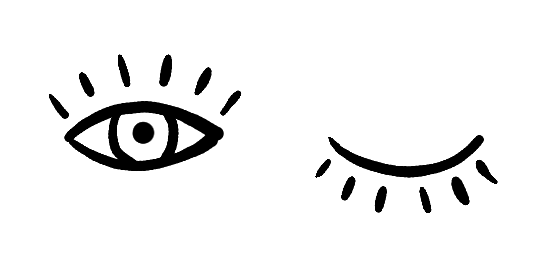
Laisser un commentaire