En parlant avec mon père des élections européennes à venir, je me rendais compte que mon choix de vote était en fait principalement motivé par les arguments, opinions et sources politiques de mon compagnon.
Je me suis rendu compte que ma grand-mère vote comme son mari le faisait.
Que ma sœur vote comme son compagnon pense.
Que ma mère, dont je ne connais pas non plus le bulletin de vote, vote probablement comme mon père.
Je ne suis pas convaincue que ces femmes aient créé elles-mêmes leur propre opinion à partir de sources externes à leur couple. Je pense qu’elles n’ont pas d’autre avis sur la question que l’avis que leur mari ou compagnon leur a transmis.
Dans ma famille, les femmes ne font pas de politique (sauf une tante par alliance et une belle-sœur !). Moi, je n’ai jamais écouté les informations, j’étais nulle en histoire. Mon travail : aimer, prendre soin et pardonner. En classe de seconde, testant la filière économique et sociale, alors qu’on me demandait de recenser tous les partis politique que je connaissais, page blanche. Immaculée.
La politique, ce n’est pas prendre soin, ce n’est pas aimer, ce n’est pas pardonner. C’est un jeu qui assume la tension, puisque l’équilibre démocratique tient au fait que des polarités (parfois extrêmes) s’opposent. C’est un état de conflit permanent où il faut accepter, voire aimer prendre un camp et maudire le camp adverse, même si ce qu’il dit nous paraît parfois sensé. Tout le contraire de ce qu’on m’a appris : reconnaître mes erreurs, cultiver le doute, et surtout, surtout, aimer et pardonner.
J’en suis venue à la politique parce que j’ai compris qu’on m’avait un peu enfumée : aimer autour de soi, ça ne suffit pas à lutter pour la paix. La liberté est un droit qui se défend, et parfois avec violence. Mais bien sûr, il vaut mieux ne pas dire ça aux petites filles, qui doivent devenir mères. Il vaut mieux qu’elles n’aient pas trop de sens de la comptabilité et de la tension. Elles seront là pour le bien, pour le bon, pour l’agréable. Pour les enfants. Pour le mari.
Si l’on commence à compter, à penser comme des politicien·nes, à penser « droit », à penser « économie », que devient la famille ? Que devient tout ce travail gratuit donné à perte, sans reconnaissance, dans lequel l’État a le droit, sans contrepartie, de fourrer son nez et détruire s’il le veut votre travail ? Que devient l’amour ? Que devient le sexe conjugal ?
Une illusion qui permet de ne pas compter, une illusion qui permet de se faire avoir sans jamais être en colère.
Je me suis rendu compte que je vote comme mon compagnon. On est très lié·es idéologiquement. Mais la question politique, ce n’est pas moi qui la porte. Je ne me suis jamais renseignée sur les autres partis qui existent, et je ne sais pas du tout lequel j’aimerais voir gagner à des présidentielles.
J’ai cru volontairement rejeter la politique. En réalité, j’étais en proie à un fait social. Les femmes sont extérieures à la politique. Sauf à avoir une famille féministe, ce qui n’était pas mon cas, on apprend dans son enfance à ne pas faire de politique. Exit la colère, émotion de la révolte, on nous laisse la tristesse, émotion du deuil, émotion de celle qui sait déjà qu’elle a perdu et sait qu’elle doit se résigner.
J’ai cru volontairement vouloir faire de la « micro-politique », une politique du local, de la petite échelle. Je n’avais pas vu que c’était propre à mon genre de faire de la politique ainsi : des petits pas de fourmi, en toute humilité, en tout respect, en tout amour… En réalité ces idées ne m’appartiennent pas. Pas plus que l’idée que je suis hétéro, que je suis une fille, que j’aime mes enfants. J’ai appris tout ça, dans un rôle de genre.
Mais je n’aime pas les idées toutes faites. Parce que les idées toutes faites sont rigides. On ne sait pas pourquoi on les a, on ne peut pas négocier avec. On ne peut pas décider de changer le tour, ou le milieu, ou de tout jeter. On a l’idée, elle est là d’un bloc et c’est tout.
Cette idée que je suis hétéro, depuis que je l’ai remise en question, elle est bien plus rigolote. Je peux mettre tout ce que je veux à la place. J’en change régulièrement les contours. Quand je croise une nouvelle personne je la décore, je lui demande comment iel la trouve, et je change la déco si je suis convaincue. Je me fais mon idée. Depuis que je l’ai remise en question, cette idée est dynamique et elle m’appartient davantage.
Je ne me suis jamais tellement fait mon idée, en politique. Je n’avais pas envie d’écouter des discours médiocres, changeant selon les saisons, et haineux. Donc j’ai suivi mon compagnon. D’après nos idéologies, on pouvait penser qu’il avait choisi ce qu’il y avait de plus cohérent.
63 % des français s’inscrivent dans la ligne idéologique de leurs parents.
La politique dans la chaîne des générations, Quelle place et quelle transmission ?, Anne Muxel
Et puis je me suis rendu compte que mon compagnon vote comme son père. Sa mère, bien entendu, vote comme son mari. C’est terrible, je ne vote même pas selon le jugement de la mère de mon compagnon, mais selon le jugement de mon beau-père, amandé par celui de son fils… En gros, je m’inscris dans une idéologie politique patrilinéaire… Après mon père, mon compagnon.
Alors, le tableau est pire que je croyais : les femmes ne votent pas seulement comme leur mari, produit de sa mère et de son père. Elles votent comme leur père, qui vote comme son père, qui vote comme son père, tous ces hommes ayant échangé entre eux, ayant construit des points de vue ensemble. Les femmes ne portent pas seulement le nom de leurs maris, qui descend de la lignée masculine, elles portent aussi leur bulletin de vote, qui descend ainsi les générations. Elles le doublent, pour être plus exacte… La patrilinéarité n’est pas que dans le nom, elle est aussi dans le bulletin de vote…
La politique n’est pas sujet entre les femmes, et s’il l’est, il ne sera jamais, ô grand jamais en non-mixité. Par contre au contraire, on constate que les hommes parlent très régulièrement de ce sujet en non-mixité. Lorsque les femmes parlent politique entre elles, elles parlent politique domestique : comment fais-tu pour que ton mari t’aide dans les tâches ménagères, comment soutenir la mixité sociale de mon enfant alors qu’iel est en école privée (les riches ont de sacrés problèmes), droit du travail parfois mais auquel cas un mec passe par là pour nous mansplainer le sujet (tiens, même quand ça parle de harcèlement sexuel, bizarre)…
Si on s’intéresse à la sororité sur le sujet de la politique (de grande échelle), j’ai bien peur qu’elle n’existe pas. Le lien entre les femmes sur le sujet de la politique, en ce qui concerne mon entourage, est quasiment absent. Je constate que même avec mes amies – davantage choisies que les femmes de ma famille, et davantage politisées – nous n’en parlons que très peu et nous en venons très rapidement à des préoccupations d’actions à échelle domestique.
Je ressors de cette réflexion avec une soif de politiser davantage mes échanges avec les femmes, par le seul fait que la politique de grande échelle devienne un sujet entre nous, un sujet dont nous parlons. J’ai envie de regarder si lorsque nous le faisons, un homme est présent et quelle est sa posture : dominante ?, discrète ?, enseignant ?, élève ?. J’ai envie d’échanger avec ma mère, ma grand-mère, ma sœur, et que nous teintions nos avis, que nous créions nous aussi une linéarité.
J’ai envie de regarder les limites. J’ai comme hypothèse que certains principes new age de développement personnel et de modestie (qui se font les relais des croyances non-violentes judéo-chrétiennes pour éteindre nos colères) prendront rapidement le dessus sur des principes géopolitiques. Comme nous faisons des chantier en non-mixité pour se réapproprier des disciplines desquelles nous sommes coupées, j’ai envie de me réapproprier la politique. Peut-être verrait-on des propositions de partis qui cherchent réellement à défoncer le patriarcat ?
Je parle de mon entourage, qui est spécifique, mais il me semble intéressant que tout le monde se pose cette question : hommes, femmes, trans, cis, comment s’inscrit-on dans l’espace politique, comment voit-on les autres le faire, comment soutient-on la politisation des personnes ?
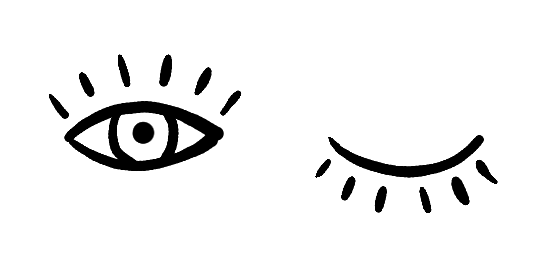
Laisser un commentaire