Je ne pleure plus, maintenant – ou presque plus – quand je lis ces livres. De temps en temps j’ai les yeux qui se mouillent, c’est à tous les endroits où c’est la première fois que je lis des mots qui parlent de moi.
C’est toujours dur d’ouvrir ces bouquins. Mais une fois ouverts j’y retrouve juste un endroit familier. C’est pas vraiment la chambre d’une copine. C’est plutôt la chambre humide et dégueulasse de l’enfance que tu laisses derrière toi. Mais c’est familier, vous voyez. C’est un peu comme l’odeur des poubelles. Ça pue, on peut pas dire que t’as envie d’y aller. Mais cette odeur elle te dit « au fait, tu te rappelles ». Tu la connais, tu sais ce que ça veut dire, tu sais très bien où t’es, et comme t’as fait avec pendant longtemps, tu fais encore avec quand t’es plongée dedans. Tu retrouves une façon d’être que tu connais. Un vieux mécanisme dont tu t’étonnes qu’il se remette en marche aussi facilement. Mais oui, il le fait.
Les premières fois je pleurais, je tremblais, je cauchemardais. J’avais cette envie irrépressible d’en savoir plus. Sur moi, sur elles, sur leur histoire, sur la sociologie. Je voulais tout savoir des mécanismes psychologiques qui font qu’on oublie, qu’on ressasse, qu’on se rappelle exactement du son du souffle derrière l’oreille, du bruissement du drap. L’étrange intensité de ces souvenirs-là.
Je ne pleure plus, j’ai comme usé ma propre peine, ma propre panique à leur ressembler, à ces victimes.
Il y a eu toutes ces premières fois où je les ai lues. Une première fois pour chaque impression, pour chaque douleur, chaque sensation qu’elles partagent – qui ont chaque fois fait flamber mon ventre, gonfler ma gorge, trembler mes bras mes jambes, sauter mes poumons, jaillir de mes yeux les émotions en sanglots. Elles me traversaient, comme ça, parce qu’elles avaient trouvé leur chemin ; des mots pour sortir de moi. Elles ont mis tous les mots dont j’avais besoin.
Les premiers livres ouverts, il y avait trop de toutes ces sensations. Trop de ces mots qui sonnaient justes pour moi, trop de ces mots-là que j’aurais pu écrire, trop de monde qui s’agitait dans mon corps pour que tout puisse se réveiller d’un coup. Un corps c’est fragile, quand même. Ça a pris des années de déploiement, de lectures, de jaillissements inopinés au détour d’une image, d’un paragraphe. Avec le temps, avec les jaillissements successifs, c’est comme si la source avait tari. Comme si maintenant, quand on ouvre le robinet, il reste encore des gouttes, il reste encore des gouttes pour les émotions retardataires, qui n’avaient pas encore été appelées. Elles sont plus lentes, plus douces. On aurait presque envie de les pousser un peu avec le pied.
Ou peut-être que je suis juste fatiguée de pleurer. Que j’ai tout usé, que je n’ai plus rien envie de ressentir quand je lis ces livres. Peut-être que j’en ai marre de ces cauchemars de possession et de petites filles torturées. Que j’ai envie d’être quelqu’un d’autre que celle que j’étais la première fois. Peut-être que je suis seulement lassée. On peut se lasser de sa propre sensiblerie ? Lassée que mes nerfs tracent les mêmes chemins sensoriels au travers de mon corps pour enserrer mon cœur. Ressentir encore les mêmes terreurs et les mêmes tristesses. Ça existe, l’ennui de l’intensité tragique ?, qui fait qu’on préfère l’ennui vide, celui du dimanche-après-midi-ciel-blanc avec Satie en bande son ? (chiaaaant)
Par contre j’ai toujours ce sentiment d’étrangeté, aux endroits où nous sommes différentes. « Tiens, moi ça m’a jamais fait ça ». Ça me rassure, parce que je sens que je découvre réellement, et ça confirme que les endroits où je sais, je le sais vraiment. Et puis on ne peut pas porter tout le malheur du monde, non plus.
J’ai eu un moment de déréalisation en lisant ce livre. J’ai cru que je l’avais écrit. Que j’avais écrit ce livre puis que j’avais oublié que je l’avais écrit. J’ai eu un vertige, ça a peut-être duré quelques minutes, où mes propres mains ne semblaient pas être mes mains. J’ai eu le temps de me demander si Maël savait que c’est moi qui l’avais écrit. J’ai cru que j’avais tout oublié, presque toute ma vie, en oubliant un bout de moi. Après je me suis rappelée qui je suis. Après j’ai eu un peu honte.
Il n’y a presque plus rien que je ne connaisse pas sur ce sujet. D’autres victimes ? D’autres survivantes ? L’ampleur du désastre ? Non, je la connais.
La dernière chose qui reste, c’est le doute permanent. Qui. Quand. Comment. Et il n’émeut plus rien en moi. Il est froid. Il est là comme s’il restait dans mon ventre depuis que tout a jailli. Il est vide. Peut-être qu’il finira par s’exprimer, et comme tout est déjà sorti, il ne sera qu’une coquille vide, l’enveloppe terne des émotions qui ont déjà brûlé dans mes pleurs. Il sera vide comme la mue d’un serpent. Un fait. Et quand je le verrai enfin, je dirai simplement : « ah ». Et ce sera fini.
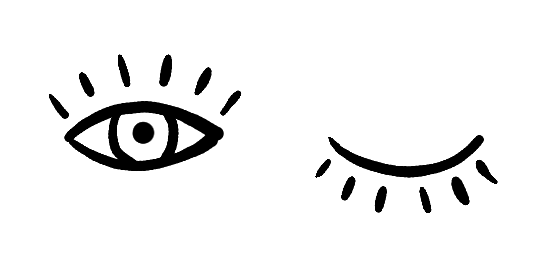
Laisser un commentaire